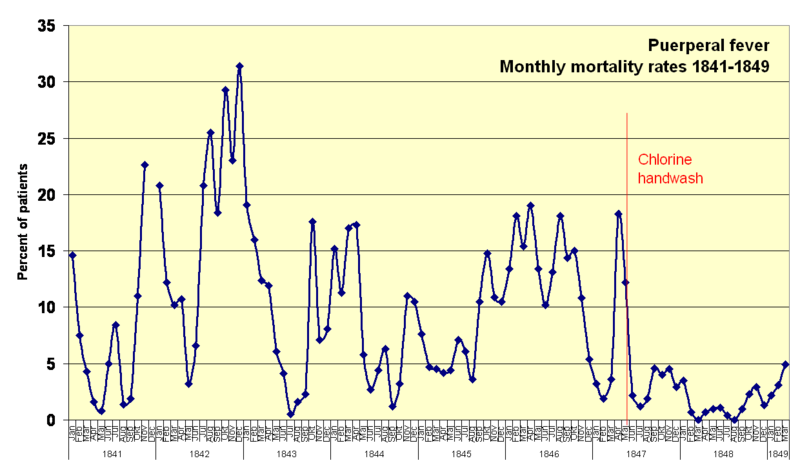8 ) Le diagnostic de la pneumonie
La radio est l’étalon-or du diagnostic de pneumonie (voir ici). Ensuite, vient le test microbien. Puis après, viennent l’analyse des symptômes cliniques, ainsi que l’analyse de l’histoire du patient.
– La radio
En fait, on pourrait ne pas analyser le problème. En effet, la radio ne prouve en rien que le problème soit microbien. Or, c’est bien de ça que traite l’article.
Par ailleurs, autant pour la tuberculose, la radio était potentiellement une preuve qu’il y avait quelque chose de mauvais et d’assez particulier (à défaut de vraiment spécifique), à cause des larges cavités qu’elle était censée révéler. Autant pour la pneumonie, ça n’est pas du tout un élément particulièrement probant ; parce qu’il y a plein d’autres problèmes non microbiens qui peuvent entrainer ces opacités. Ça n’est absolument pas spécifique.
Mais tout de même, il est intéressant de savoir ce qui se cache derrière les résultats de la radio. Dans la mesure où l’orthodoxie se repose fortement sur la radio pour convaincre la personne qu’elle a une atteinte physique réelle et qu’elle risque donc de mourir rapidement, il est important de savoir si c’est vraiment le cas ou non, et quelle est la fiabilité de cet outil.
Le problème principal, c’est que la radio n’a quasiment aucune valeur de diagnostic pour ce genre de problème.
Déjà, il faut comprendre que ce qui opacifie une radio, ce sont les structures denses. Donc, l’air qui a une faible densité apparait noir. Et les os, qui sont denses, apparaissent blancs. Les chairs et l’eau opacifient également les radios ; mais là, ça dépend de leur épaisseur, de leur densité et du réglage de la radio. Si leur épaisseur et leur densité sont importantes, la radio va apparaitre opaque (blanche). Alors que si elles sont faibles, la radio apparaitra noire.
Ca explique pourquoi les poumons apparaissent noirs, alors que pourtant, les rayons-x traversent de la chair, qui peut potentiellement opacifier la radio. S’ils apparaissent noirs, c’est qu’on règle l’intensité du rayonnement à un niveau qui lui permet de traverser complètement les poumons. Et si les autres chairs (par exemple le cœur) n’apparaissent pas noires c’est que leur épaisseur et leur densité sont plus importantes que les chairs des poumons.
Donc, d’où peuvent venir les larges opacités sur les radios des poumons ? Eh bien, dans le cas présent, vu qu’on ne parle pas de tumeurs, il ne peut y avoir essentiellement qu’une origine : l’eau. Il ne peut pas y avoir d’autre cause. C’est la seule chose qui est présente dans le corps et qui peut opacifier de larges zones des poumons en s’accumulant rapidement. Dès que les cellules des poumons se gonflent d’eau, la densité des poumons augmente et leur épaisseur aussi, et des opacités apparaissent à la radio. Une autre cause, éventuelle, mais qui ne concerne que des zones limitées ou diffuses, c’est l’engorgement du système lymphatique.
Donc, ces opacités qui apparaissent soudainement et sur des larges zones sont forcément causées par une accumulation d’eau dans les cellules. Ce que montrent les radios, ce sont des accumulations d’eau dans les cellules des poumons, rien de plus. D’ailleurs, l’orthodoxie dit la même chose. Pour elle, s’il y a opacité dans le cas de la pneumonie, c’est que les poumons se gonflent d’eau. Sauf que pour elle, c’est de l’inflammation.
Mais, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que la radio n’a quasiment aucune valeur.
En effet, si c’est l’augmentation de la quantité d’eau dans les poumons qui provoque l’apparition des opacités, alors se pose une question cruciale : « à partir de quel seuil d’augmentation de la quantité d’eau, la radio s’opacifie-t-elle ?« .
C’est essentiel. Parce que si elle s’opacifie à partir d’un seuil élevé, alors, on peut penser qu’il y a effectivement un problème important, puisque qu’il y a une forte accumulation d’eau. Si elle s’opacifie à partir d’un seuil faible, on peut penser que le problème n’est souvent pas important, puisqu’il suffit d’un léger gonflement pour que la radio s’opacifie.
Eh bien, avec les éléments qu’on a, on peut penser qu’elle s’opacifie à partir d’un seuil assez bas. En effet, puisque la plupart du temps, les pneumonies qui présentent une radio opaque se guérissent en seulement 15 jours, ça veut clairement dire que le problème était tout à fait bénin et qu’il ne s’agissait, comme j’en défends l’idée, que d’un problème d’augmentation du taux de cortisol ou de prise d’analogues d’opiacés. Si le problème était bénin, ça veut donc bien dire que l’accumulation d’eau était limitée.
Donc, il suffit d’une augmentation faible de la quantité d’eau pour opacifier la radio. Peut-être que 10 ou 20 % d’augmentation de la quantité d’eau dans les cellules suffisent pour opacifier la radio. En fait, on règle l’appareil sur une très grande sensibilité. Donc, un rien le fait réagir. On obtient donc facilement des cas dès que la personne n’est pas exactement dans les normes.
Donc, à partir de là, la radio ne signifie quasiment rien.
Il y a un autre élément important. Puisque l’opacité dépend de l’épaisseur du milieu traversé, il est quasi certain qu’on adapte la radio à la corpulence de la personne. Si la personne est grosse, on doit augmenter le rayonnement pour ne pas avoir une radio complètement blanche. Inversement, si la personne est maigre et déshydratée, on doit diminuer le rayonnement pour éviter qu’elle ne soit complètement noire.
Et effectivement, on en a une confirmation ici (encyclopédie Larousse sur la radiographie pulmonaire) : « Pour obtenir une image convenablement exposée des deux poumons, l’opérateur règle l’appareillage en fonction de la corpulence du sujet, à qui il demande de prendre une inspiration profonde et de bloquer la respiration pendant l’exposition.«
Ou encore ici :
« Dans le service de pédiatrie de mon établissement, les paramètres évoluent beaucoup selon la corpulence du patient. Du prématuré à l’adolescent fan de fast food, les paramètres des clichés au lit varient de min (50 kV, 1,25 mAs) à max (80 kV, 2 mAs). »
Mais du coup, ça veut dire qu’on adapte les réglages à chaque personne. Or, rien ne dit que l’adaptation est parfaite. On doit savoir approximativement qu’à telle corpulence et poids, on doit donner telle dose de rayons. Mais on n’est pas sûr que ce soit forcément bon. Donc, plein de personnes doivent avoir un diagnostic de radio opaque, alors que c’est simplement l’adaptation qui a été mal faite.
En fait, avec cette façon de faire, il est possible aussi de trouver des cas chez les personnes maigres et déshydratées. Normalement, la maigreur et la déshydratation devraient entrainer une radio sans opacités. Mais puisqu’on adapte, on peut encore trouver des cas. Et justement particulièrement dans ces populations. En effet, quand une personne est déshydratée, les poumons ne doivent pas l’être dans toutes les zones. Donc, on est dans un cas où les différentes parties des poumons ne vont pas être logées à la même enseigne. Donc, en adaptant le rayonnement (en le diminuant), on va trouver des opacités à certains endroits et pas à d’autres.
Ceci semble aller dans ce sens :
« Malheureusement, la radiographie du thorax n’est pas un outil de dépistage parfait, et les patients peuvent avoir une radiographie normale vis-à-vis de la pneumonie. Certaines autorités croient qu’une telle chose est plus susceptible de survenir chez des patients souffrant de déshydratation ainsi que ceux avec une neutropénie profonde. Toutefois, la preuve scientifique concernant ceci est maigre. »
D’ailleurs, il est dit ici que l’idée que l’hydratation influence la radio est assez répandue dans le milieu des radiologues.
(departments of Family Medicine (R.B.H.) and Internal Medicine (J.L.S.), Mercer University School of Medicine (M.B.L.) and the Family Practice Residency Program, Medical Center of Central Georgia (R.L.V.), année 2000)
« Arrière-plan : beaucoup de médecins croient que les radios des pneumonies communautaires sont influencées par le volume des fluides du patient. Cependant, il y a peu de données pour supporter ou réfuter ce concept. Avec cette étude, nous avons commencé à examine la relation entre le volume de fluides et la radio des pneumonies communautaires« .
Donc, beaucoup de médecins croient que plus il y a d’eau dans le corps, plus la radio risque de s’opacifier et que moins il y en a, moins ce risque est présent. Ce qui est assez normal, vu que ça tombe sous le sens. C’est même presqu’indispensable pour les radiologues de comprendre ça pour réussir à obtenir ce qu’ils veulent. Mais là, on en a la confirmation. On peut penser qu’en pratique, c’est la prise ou la perte de poids qui servira d’indicateur aux radiologues sur l’adaptation à apporter concernant le rayonnement.
Mais du coup, ce genre de petite cuisine ouvre la porte à des possibilités de traficotages discrets. On adapte on adapte ; et puis on se met à traficoter. Des traficotages en toute bonne foi, mais traficotages quand même. En effet, le médecin va souvent savoir si le patient est suspecté d’avoir quelque chose d’important. Donc, peut-être que si le sujet est suspecté d’avoir une pneumonie (ou une autre affection des poumons), le technicien va régler le rayonnement sur « un peu moins fort » (par rapport au rayonnement standard pour un sujet de la corpulence X), pour obtenir plus d’opacités. Et du coup, le technicien créerait les opacités. D’ailleurs, ça n’est pas forcément au cas par cas et à l’initiative du technicien. Ça peut carrément être codifié et standardisé au niveau de l’hôpital (ce qui ôte le caractère de traficotage un peu honteux. Là, le technicien ou le médecin n’a pas l’impression de truander, puisque c’est quelque chose de codifié par les responsables). Par exemple on peut dire que pour une personne de telle corpulence, supposée fortement déshydratée, et suspectée d’avoir une pneumonie, on va régler l’appareil avec telle intensité de rayonnement. Mais même si c’est la direction qui dit de faire ça, les acteurs de ces traficotages ne vont pas aller en parler ouvertement aux patients. Ca la foutrait quand même mal. Et puis, dans la mesure où c’est de la cuisine non officielle (au niveau national) ça signifie que les réglages vont être propres à chaque hôpital. Donc, pour un même cas, dans tel hôpital, on va diminuer la puissance du rayonnement de disons 20 %, alors que dans un autre hôpital, ça sera de seulement 10 %. Bien sûr, il ne s’agit ici que d’une hypothèse. Rien ne dit qu’il y ait ce genre de traficotages. Mais c’est bien dans le genre des techniciens de faire ce genre de choses. Cela dit, c’est déjà bien n’importe quoi sans ça. Donc, ça n’est pas indispensable.
C’est pour ça que les opacités peuvent changer d’une radio à l’autre. Un gars qui fait une radio à tel moment dans un hôpital, et qui en fait refaire quelques jours plus tard dans un autre hôpital peut avoir des résultats complètement différents.
Le problème, c’est que quand on commence à adapter le rayonnement pour des raisons de corpulence, on peut peut-être continuer à le faire pour d’autres raisons. Raisons qui semblent très probablement tout à fait légitimes pour le radiologue ou les médecins en général. Qu’un élément de diagnostic soit influencé par d’autres éléments de diagnostic déjà collectés, ça ne va pas sembler choquant pour les médecins.
Par ailleurs, il est possible que la notion de groupe à risque intervienne là aussi dans le réglage du rayonnement. Et cette notion est considérée comme parfaitement légitime par les médecins. Donc, adapter le rayonnement en fonction de l’appartenance à un groupe à risque ou à une suspicion de problème peut leur sembler normal. Alors, il est possible que ça ne soit pas appliqué de façon directe. Mais ça peut intervenir de façon indirecte via la suspicion plus ou moins forte de pneumonie. Par exemple, une personne de 90 ans, vivant en maison de retraite, et s’étant fait opérer dans un service qui a connu quelques cas de pneumonie récemment, et qui développe une détresse respiratoire, va être considérée par les médecins comme fortement à risque d’avoir un problème pulmonaire important. Et c’est via cette estimation de probabilité importante de problème pulmonaire grave qu’on diminuera le rayonnement pour augmenter les chances de trouver des opacités à la radio. Donc, on ne dit pas forcément de but en blanc « c’est une personne à risque, il faut diminuer le rayonnement », mais plutôt « il y a une forte probabilité de pneumonie ou autre infection grave des poumons, diminuons le rayonnement pour avoir une image bien nette ».
Et puis, il y a peut-être des zones de poumons où il y a un peu plus d’eau qu’ailleurs. Donc, il est peut-être possible d’obtenir quelque chose simplement à cause de ça. On suppose que l’épaisseur et la densité sont pareils partout, mais rien ne dit que ça l’est.
Bien sûr, on peut me dire que l’important, ce sont les différences d’épaisseur et de densité entre les zones des poumons. Donc, si une personne est en bonne santé, il ne va pas y avoir ce genre de différences. Les radios vont apparaitre totalement noires ou totalement blanches (si l’intensité du rayonnement est faible). Mais en fait, il y a de fortes chances que, même chez des personnes en bonne santé, les zones des poumons ne soient pas uniformes en ce qui concerne l’épaisseur et la quantité d’eau des tissus. Si les radios apparaissent comme uniformément noires, c’est qu’on doit pousser le rayonnement légèrement au-dessus du seuil qui rendrait opaque les zones les plus épaisses et les plus denses. Donc, il suffirait de diminuer légèrement le rayonnement pour que ces zones apparaissent.
Et justement, comme on l’a vu, on joue sur la force du rayonnement en fonction de la corpulence de la personne. Et il est possible qu’on joue dessus aussi en fonction de l’affection qu’on suppose qu’elle a.
Donc, dans la mesure où l’épaisseur et la densité ne sont pas pareilles dans toutes les zones des poumons, dès qu’on se met à jouer sur l’intensité du rayonnement, c’est la porte ouverte au n’importe quoi. On peut créer les opacités sur la radio simplement en diminuant trop le rayonnement. Donc, on va créer des cas au hasard. Et si, comme on peut le penser, on adapte le rayonnement à la tête du client, alors, on crée des cas, non plus seulement au hasard, mais de façon ciblée.
Bien sûr, probablement qu’on ne va pas avoir des opacités très marquées. Mais il y en aura. Et s’il y a des variations de quantité d’eau dans les cellules, les opacités naturelles pourront devenir assez marquées.
En fait, on est dans une zone très étroite. Entre l’absence totale de réaction chez 100 % des gens, et la réaction chez 80 % des gens, la frontière est très étroite. Elle est tellement étroite que les radiologues sont obligés de jongler avec l’intensité du rayonnement pour obtenir ce qu’ils sont supposés obtenir. Il ne doit pas y avoir loin du noir complet à l’opacification.
Et bien sûr, tout ça, c’est s’il n’y a pas accumulation d’eau dans certaines zones. Si ça arrive et que ça correspond aux zones où il y a naturellement plus d’eau qu’ailleurs, on va avoir des opacités bien marquées.
On a parlé des cas de poumons « normaux ». Mais certaines situations peuvent entrainer que les cellules des poumons accumulent de l’eau.
Alors, pourquoi les cellules des poumons se remplissent d’eau ? Déjà, il y a bien sûr l’augmentation du taux de cortisol. Ca provoque une accumulation d’eau dans le centre du corps et donc, aussi dans les cellules des poumons. Ça va être une raison majeure d’augmentation de la quantité d’eau dans les poumons. Et comme la répartition de l’accumulation ne se fera pas de façon uniforme dans les poumons, des taches opaques apparaitront, qui seront considérées comme la preuve d’une pneumonie (ou d’autre chose).
Il est vrai que les personnes qui se font diagnostiquer une pneumonie ont souvent plutôt un taux de cortisol faible ou sont déshydratées à cause de la consommation d’analogues d’opiacés. Donc, elles ne devraient pas avoir d’augmentation de la quantité d’eau dans les poumons. Mais ce qui doit se passer assez souvent, c’est qu’on donne des antibiotiques peu de temps avant de faire la radio. On va les donner souvent pour soigner une autre infection détectée, ou parce qu’on soupçonne déjà qu’il y a une pneumonie. Donc, les antibiotiques vont augmenter le taux de cortisol, les cellules des poumons vont se remplir d’eau, et des opacités vont être détectées à la radio.
Ca expliquerait pourquoi on ne peut généralement trouver des opacités pour la pneumonie qu’après quelques jours. En effet, il est considéré comme normal qu’au début, il n’ait pas de signes radiologiques. L’interprétation officielle est qu’ils n’ont pas eu le temps de s’installer parce que la pneumonie est trop récente.
C’est ce qu’on peut lire sur la page de Doctissimo sur les pneumonies bactériennes :
« La radiographie pulmonaire est normale au début, puis après quelques jours confirme le diagnostic en montrant une opacité dense, homogène, à bords rectilignes, atteignant un segment, un lobe voire tout un poumon.«
En fait, c’est le temps qu’on administre le traitement antibiotique. Si on fait une radio alors que le traitement antibiotique n’est pas encore commencé, on ne va généralement rien trouver. Mais si on en fait une après quelques jours de traitement, on va avoir des résultats beaucoup plus souvent.
Normalement, les opacités ne devraient pas partir durant le traitement, puisque la personne est sous antibiotiques pendant 15 jours. Et justement, c’est le cas. Elles ne partent qu’après environs 3 semaines ou un mois. Donc, elles partent quand le taux de cortisol est à nouveau bas.
Dans les pays pauvres, il va y avoir souvent automédication ou médication via des guérisseurs ou des sorciers. Et les produits utilisés vont souvent être des augmentateurs du taux de cortisol. Du coup même problème, le centre du corps aura déjà commencé à se remplir d’eau, et des opacités apparaitront à la radio.
Dans les pays chaud, si une personne est en état de déshydratation parce qu’elle n’a pas pris assez d’eau et qu’il fait trop chaud, il va y avoir perte de poids, mais hausse du taux de cortisol (parce que là, la déshydratation est naturelle et que le cortisol sert justement à gérer ce genre de situation). Le tronc va perdre moins d’eau que le reste du corps. Donc le radiologue va utiliser un rayonnement trop faible qui va aboutir à la mise en évidence d’opacités. Cela dit, même dans les pays chauds, cette situation sera relativement rare. La perte de poids sera généralement plutôt liée à une baisse de taux de cortisol.
Par ailleurs, le fait que les antibiotiques agressent les reins peut parfois entrainer une insuffisance rénale plus ou moins importante. Les liquides corporels n’étant plus éliminés par cette voie-là, il y a rétention d’eau. Ce qui peut créer des œdèmes, entre autre dans les poumons. Par ailleurs, si le ventricule gauche du cœur n’assure plus correctement son rôle, de l’eau peut là aussi s’accumuler dans les poumons. Pour la mort de Christine Maggiore (une dissidente du sida), il a été mis en avant par la personne ayant réalisé l’autopsie qu’à cause d’une insuffisance rénale aigue causée par la prise d’antibiotiques à hautes doses, les poumons se sont remplis d’eau. Dans le cas en question, il est très possible que ça ait causé la mort, puisque l’autopsie a révélé qu’il y avait 750 % d’eau en plus par rapport à la normale. Un poumon pèse en général entre 300 et 400 g. Alors que là, il pesait 2626 g. Le médecin ayant pratiqué l’autopsie a incriminé également une défaillance du ventricule gauche. On a plus de détails sur ce problème ici et ici.
Enfin, le système lymphatique peut aussi s’engorger. Ce qui peut éventuellement apparaitre à la radio.
Donc, il y a plusieurs raisons possibles à une accumulation d’eau dans les cellules des poumons. Mais, dans la mesure où les problèmes pulmonaires sont essentiellement causés par la variation du taux de cortisol et les médicaments, il est clair que la plupart du temps, le problème n’est pas si grave. La quantité de cas bénins outrepasse largement la quantité de cas graves. D’autant plus qu’un bon nombre de cas graves sont correctement diagnostiqués comme pneumonies non microbiennes ou autres affections (silicose, œdème pulmonaire, pleurésie, etc…).
Pour en revenir à la radio en général, le problème c’est donc que ça n’est pas fiable. Difficile de savoir si on est vraiment face à un cas grave, à un cas bénin ou à un cas bidon. Une radio positive couvre un spectre de cas tellement large qu’il est impossible de s’y fier.
Vu que les radios ne sont pas fiables, normalement, une radio considérée comme positive à la pneumonie n’est pas très spécifique, et il doit y avoir des divergences entre radiologues, sur le diagnostic à prononcer.
Et effectivement, les avis des radiologues divergent concernant le fait qu’une radio montre des symptômes de pneumonie ou non. Je n’avais pas trouvé de documents parlant de problèmes d’interprétation pour la tuberculose (cela dit, je n’avais pas trouvé de bons mots-clés à ce moment-là). Mais pour la pneumonie, on en trouve facilement.
Ici (site de l’OMS), on a ça :
« Bien que la radio des poumons pour la pneumonie soit utilisée comme une mesure de résultat dans les études épidémiologiques, il existe une variabilité considérable dans l’interprétation des radiographies pulmonaires.«
Un peu plus loin :
« Bien que les résultats radiologiques soient communément admis comme le «gold standard» pour définir la pneumonie, il n’y a pas de définitions validées pour l’interprétation des radiographies. En outre, la variabilité inter- et intra-observateur dans l’interprétation des radiographies pulmonaires est un problème bien reconnu et a été étudié dans le diagnostic de la tuberculose, de la pneumoconiose, du cancer du poumon, et de la pneumonie des adultes. Pour la pneumonie infantile, à l’exception de quelques études, ce problème n’a pas été suffisamment pris en compte.«
Encore ici :
« Il existe une variabilité inter-observateurs considérable dans le diagnostic radiologique de la pneumonie – une variabilité qui ne s’améliore pas avec une plus grande expérience médicale. Dans une étude comparant les médecins de différents niveaux d’expérience, un accord avec un « gold standard » (3 radiologues) était pauvre. Les opacités lobaire dense ou segmentaires ont été unanimement reconnues comme des pneumonies, tandis que des opacités irrégulières et la maladie alvéolaire diffuse ont été fréquemment manquées comme signes de pneumonie, ou mal interprétées. »
Ici, on a :
« Dans l’une des études, par exemple, les enquêteurs ont demandé à deux radiologues de revoir les clichés de la poitrine de patients qui étaient supposés avoir une pneumonie. Les chercheurs ont constaté que souvent, même des médecins formés à la lecture des radios ne pouvaient pas tomber d’accord sur le fait de savoir si les patients avaient un infiltrat ou non.
« Si le patient avait une BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), les résultats étaient décourageants » a déclaré le Dr Flander, « les radiologues étaient souvent en désaccord. Le taux d’accord était un peu meilleur s’il n’y avait pas de BPCO. «
Ce qui est plus intéressant, cependant, c’est que même lorsque les patients se mettaient à développer clairement une pneumonie à pneumocoques, les radiologues ne pouvaient souvent pas tomber d’accord sur le fait de savoir si un infiltrat était visible sur le film.
Le Dr Flanders a souligné également qu’alors que les deux radiologues ont identifié un infiltrat dans seulement 15 des sujets de l’étude, les médecins ont traités la plupart des 250 patients pour une pneumonie.
« De toute évidence, la radiographie du thorax n’influence pas nos décisions de traitement » a déclaré le Dr Flanders. « Même les radiologues ont du mal à s’entendre sur le fait que quelque chose est un infiltrat« . »
Donc voilà, comme on pouvait s’y attendre, les avis des radiologues divergent sur une même radio. La raison en est que plein de maladies peuvent fournir les mêmes symptômes, et probablement que même des personnes normales peuvent avoir ces symptômes.
On en trouve une confirmation du premier point (d’autres maladies peuvent fournir les mêmes manifestations radiologiques) ici :
« Malgré tout ce qui est écrit sur les caractéristiques radiographiques classiques de pneumonies causées par diverses bactéries pathogènes, les résultats radiographiques sont non spécifiques. Trouver un infiltrat sur la radiographie thoracique ne garantit pas le diagnostic de pneumonie. Les résultats faux-positifs à la radiographie peuvent être dus à un œdème pulmonaire unilatéral, des néoplasmes, une atélectasie, une pneumopathie d’hypersensibilité, une embolie pulmonaire, ou la sarcoïdose. Même les radiologues ne peuvent pas distinguer de façon fiable les pneumonies bactériennes des pneumonies virales sur une radiographie pulmonaire. Plus important encore, il est également impossible de distinguer une embolie pulmonaire d’une pneumonie sur la radio de la poitrine. »
Au passage, on note que des divergences d’interprétation entre radiologues existent aussi pour la tuberculose et pour le cancer du poumon. Donc, déjà, pour la tuberculose, on a cette donnée supplémentaire que je n’avais pas trouvée quand j’ai fait mon précédent article. Et on apprend également que pour le cancer du poumon, les interprétations divergent. C’est carrément intéressant.
Pour en revenir à la pneumonie, on constate que souvent on ne peut même pas distinguer une pneumonie d’une embolie pulmonaire ou d’un œdème à la radio. Ça craint carrément. Mais par rapport à l’analyse faite plus haut de ce qui fait positiver la radio, c’est assez logique.
Tout ce qui précède indique clairement qu’au moins dans le cas de la pneumonie, cette discipline est aussi sérieuse que la cartomancie. Les médecins voient un peu ce qu’ils veulent dans la radio. Et donc, leur interprétation va probablement être bien influencée par ce qu’on sait du patient par ailleurs. Si le patient est très âgé et a des antécédents de problèmes pulmonaires, on va avoir beaucoup plus tendance à considérer que la radio est positive que s’il s’agit d’un trentenaire en pleine possession de ses moyens.
Donc, la radio en plus de ne pas être une preuve de la présence des germes, n’est pas fiable concernant le diagnostic de problèmes pulmonaires réels de type pneumonie.
– Le cas du scanner
Le cas du scanner n’est pas complètement clair. On ne sait pas vraiment si ça sert uniquement pour détecter des lésions ou aussi pour détecter la présence de fluides dans les poumons.
Ce qu’il y a, c’est qu’on parle de l’utilisation d’un liquide de contraste injecté dans le corps. Dans la mesure où ça ne doit pas arriver à s’infiltrer dans les zones avec des lésions ou des œdèmes (ou mal irriguées d’une façon générale), ça doit permettre de les mettre en évidence. Dans ce cas, le scanner sert essentiellement à détecter des lésions.
Mais, l’usage de ce liquide de contraste n’est peut-être pas systématique. Donc, peut-être aussi que le scanner sert à mettre en évidence des zones avec plus d’eau que d’ordinaire, de la même façon que la radio. D’ailleurs, on a une preuve que le liquide de contraste n’est pas toujours utilisé sur Wikipédia (page sur la pneumonie franche lobaire aigue) : « En difficulté diagnostique, le scanner thoracique sans injection peut être réalisé« .
Concernant la détection des lésions, on avait déjà vu dans le papier sur la tuberculose, que la technique doit avoir des limitations importantes. Donc, déjà, même dans le cas de recherche de lésions, il n’est pas sûr que la technique soit très fiable. D’autant plus que contrairement à la tuberculose, on va a priori surtout avoir des petites lésions. Or, plus elles sont petites, plus la réalité de leur détection est sujette à caution.
Par ailleurs, on peut penser que beaucoup de ces lésions (celles qui sont réelles) seront induites par un traitement récemment pris. Par exemple, le traitement antibiotique administré dès l’entrée à l’hôpital peut entrainer des saignements dans les poumons. Et ceux-ci pourront être interprétés par le scanner comme des lésions causées par la pneumonie. Donc, les symptômes auront été créés par les médecins. Il est possible aussi que les antibiotiques provoquent des micro-œdèmes, qui seront considérés là-aussi comme des lésions. En effet, comme on l’a vu plus haut, les antibiotiques peuvent provoquer divers problèmes amenant à la création de gros œdèmes. Mais on peut imaginer que des œdèmes plus petits se forment à divers endroits.
Et puis, chez les personnes un peu âgées, ou qui prennent en grande quantité des substances qui agressent le corps, les lésions détectées vont souvent être anciennes. Donc, le médecin pourra être induit en erreur par leur présence. C’est une autre limitation du scanner pour ce type de recherche, ça ne donne qu’un cliché de la situation actuelle. Mais ça ne renseigne pas sur l’histoire de ces lésions, et donc si elles sont récentes ou anciennes.
Mais surtout, ce qui est important dans le cas de la pneumonie, c’est la présence d’eau dans les divers endroits des poumons, ou l’engorgement du système lymphatique. Les lésions sont peu intéressantes, puisque la maladie se développe très rapidement (donc, n’a pas tellement le temps de développer des lésions) et est surtout caractérisée par une inflammation. Donc, dans la pratique, il ne doit normalement pas y avoir beaucoup de lésions. Et elles ne doivent pas être considérées comme un gros problème. On doit donc rechercher surtout les inflammations. Donc, même si la technique pour la recherche de lésions était un peu plus fiable que celle pour la recherche d’inflammations, ça importerait peu, puisque ce sont surtout les inflammations qu’on recherche pour établir le diagnostic de pneumonie.
Et le problème de l’utilisation du scanner pour trouver des inflammations, c’est que les mêmes limitations que pour la radio doivent se présenter. Le même problème de seuil limite de réaction se pose. Comme pour la radio, on doit mettre un seuil assez bas. Donc, de la même façon que pour la radio, le scanner va être positif (présence d’opacités) trop facilement. Et il ne sera pas plus fiable.
– Le test microbien
Concernant les tests microbiens, même si là encore, il n’y a à priori pas grand-chose à dire, puisque je remets par ailleurs en cause l’origine microbienne de la maladie, il y a des éléments intéressants.
J’accepte tout à fait l’idée qu’il y ait des bactéries de découvertes lors de la maladie. Mais pour moi, elles ne sont qu’une conséquence de la maladie, et pas une cause. Donc, la découverte de microbes lors d’un diagnostic de pneumonie ne signifie pas qu’ils causent la maladie. Les tests microbiens ne prouvent donc rien.
Donc, l’orthodoxie peut trouver des germes autant qu’elle le veut, ça ne prouve rien.
Pour que ça prouve quelque chose, il faudrait prouver que si on inocule le germe, ça provoque la maladie. Seulement, comme on dit que ça touche surtout ceux qui ont un système immunitaire affaibli ou pas encore mature, on ne peut pas obtenir ce résultat. Mais en fait, on ne peut pas l’obtenir non plus avec des personnes supposément immunodéprimées. Comme la maladie se développe rapidement, même avec des immunodéprimés, il n’y aurait quasiment personne qui tomberait malade. Donc, là encore, on n’arriverait pas à prouver quoi que ce soit. Pour prouver quelque chose, il faudrait carrément cibler les personnes ayant une maladie pulmonaire chronique, ou prenant beaucoup d’opiacé-likes. Mais forcément, l’expérience perdrait alors toute valeur, puisqu’il faudrait déjà être malade pour tomber malade.
Toutefois, il est intéressant de constater qu’alors que l’orthodoxie pourrait dire que dans 95 % des cas de pneumonie sont présents des germes supposés responsables de cette maladie, ça n’est pas le cas. C’est d’autant plus bizarre qu’elle dit que la pneumonie peut être causée par de nombreux germes et virus différents. Donc, il ne devrait pas être difficile de trouver au moins un d’entre eux. Mais non, assez souvent, on ne trouve pas de germe.
On peut lire par exemple ici que :
« Un tiers à la moitié des pneumonies ne reçoivent pas de confirmation microbiologique.«
Et ici (concernant les pneumonies de l’enfant) :
« Le Diagnostic microbiologique de la pneumonie est en effet rare. »
Peu après, dans le même document, on a la raison de cet état de fait.
« Le diagnostic de certitude de l’étiologie des pneumopathies bactériennes ne peut être en pratique assuré que par les hémocultures dont les résultats contribuent en outre aux études épidémiologiques les plus précises.
Leur sensibilité est cependant faible (3 à 10 % environ).
– Les autres examens sont de recours imprécis et limités. (tableau 1)
– Les prélèvements nasopharyngés ne mettent en évidence qu’une flore commensale de portage.
– L’examen cyto-bactériologique quantitatif (interprétable si plus de 106 germes/ml, plus de 10 cellules épithéliales, plus de 25 polynucléaires neutrophiles par champ) est de réalisation souvent difficile et peut être contaminé par la flore commensale pharyngée.
– Les antigènes solubles (sang-urines) sont de sensibilité et de spécificité médiocres.
– Les méthodes de détection des antigènes bactériens par amplification génique (PCR si Mycoplasma pneumoniae) sont encore expérimentales, et réservées à des situations limitées.
– Les prélèvements avec analyse quantitative obtenus par des méthodes invasives in situ (fibroscopie bronchique et lavage broncho-alvéolaire) ne sont réservés qu’aux seules infections sévères sur terrain fragilisé.«
Juste après, on a aussi ce tableau :
Tableau 1 : place des examens bactériologiques pour le diagnostic des pneumopathies bactériennes de l’enfant
|
Prélèvement nasopharyngé |
Aucun intérêt |
|
Examens cytobactériologiques des crachats Aspiration trachéale |
Contamination oropharyngée |
|
Hémocultures (systématiques) |
Faible sensibilité 1-10% |
|
Antigènes solubles |
Très faible sensibilité |
|
Examens sérologiques |
Diagnostic rétrospectif |
|
Prélèvement invasif Biopsie pulmonaire Lavage broncho-alvéolaire |
Uniquement si malades sévères |
Voici une explication du tableau.
Le prélèvement nasopharyngé n’a évidemment aucun intérêt, puisque les germes de la pneumonie sont normalement présents dans le nez.
L’examen des crachats et l’aspiration de la trachée, c’est la même chose, puisqu’il y a contamination par les germes du nez.
L’hémoculture (analyse des bactéries ou virus présents dans le sang) n’a pas grand intérêt non plus, puisque le sang ne contient quasiment pas de germes. Donc, l’hémoculture va être rarement positive.
Les antigènes solubles, c’est la recherche d’antigènes dans le sang. Normalement, comme on peut régler la sensibilité, c’est-à-dire, truander le test comme on le veut, on peut obtenir facilement des résultats par ce biais. Mais ça n’est pas le cas ici. Donc, c’est bizarre. Mais probablement que les médecins à l’origine des tests se sont sentis obligés de régler le seuil de réaction à un niveau assez élevé (donc, faire un test peu sensible). Sinon, il y aurait eu incohérence avec les résultats de l’hémoculture.
Les examens sérologiques, c’est en fait, la mesure de la quantité de globules blancs dans le sérum. On voit s’il y a eu augmentation de la quantité de globules blancs et donc s’il y a eu réponse immunitaire. Mais, comme signalé dans le tableau, c’est forcément rétrospectif, puisque la maladie se développe d’un coup et rapidement.
Enfin, les prélèvements invasifs nécessitent de faire une anesthésie locale ou générale. C’est pour ça que ça n’est réservé qu’aux malades sévères. Mais alors, le seul examen supposé un peu spécifique n’est réservé qu’à un pourcentage assez faible des patients avec pneumonie.
Du coup, on comprend pourquoi la médecine orthodoxe ne trouve pas souvent les germes responsables de la pneumonie. C’est parce que les examens, soit ne sont pas spécifiques du tout, soit ne fournissent pas assez de bactéries ou virus.
Il semble assez clair que cette situation est liée en partie au fait qu’on ne peut pas dire que la présence du microbe cause systématiquement la pneumonie. Le fait de dire que beaucoup de monde a le microbe sur lui, et que la pneumonie est surtout un problème de système immunitaire affaibli a des conséquences au niveau des tests microbiens. Ça rend plein d’examens non spécifiques parce que les germes identifiés peuvent être ceux qu’on trouve d’ordinaire dans la zone bucco-nasale.
Cette situation aboutit à ce que, dans les cas bénin, le diagnostic repose là encore sur l’appartenance à une catégorie à risque et sur l’impression du médecin. Si la personne appartient à une catégorie considérée comme hautement à risque, même si on sait que l’examen bactérien utilisé n’est pas spécifique ou qu’il n’a rien donné, relativement souvent, on dira quand même que c’est la pneumonie. Si la personne n’appartient pas à une catégorie à risque, on dira que c’est autre chose (une bronchite par exemple). Donc, on constate que comme souvent, le diagnostic est fondé essentiellement sur l’appartenance à une catégorie à risque et sur l’impression du médecin, plutôt que sur les examens en eux-mêmes.
Un autre problème que doit rencontrer l’orthodoxie, c’est celui de l’échec thérapeutique lors du premier traitement antibiotique. Un certain nombre de fois, il doit y avoir échec thérapeutique. Et forcément, il faut le justifier. En disant qu’on n’a pas trouvé le bon germe au départ, on peut le faire (on pourrait parler aussi de résistance, mais apparemment, on le fait rarement lors du premier échec). Mais du coup, on est obligé de dire que les tests sont peu sensibles et spécifiques.
Pour obtenir ce résultat, ce qui doit se passer, c’est qu’on doit limiter la sensibilité des tests, en exigeant un seuil de réaction assez élevé.
Evidemment, ça diminue encore un peu plus la crédibilité de la théorie officielle. Parce que, si pour une maladie aussi rapide à se développer (ce qui signifie une augmentation très rapide de la quantité de bactéries), qui devrait entrainer un fort accroissement de la présence de bactéries dans les crachats, on ne trouve pas les dites bactéries facilement, ça la fout un peu mal.
Dans le document précédent, l’hémoculture est considérée comme l’examen le meilleur pour déterminer quel germe cause la maladie. Mais en réalité, dans les documents suivants, on s’aperçoit que c’est loin d’être le cas.
C’est le cas ici (powerpoint sur l’hémoculture réalisé par le Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales du sud-ouest):
« En plus des difficultés de détection des bactériémies pour les raisons énoncées ci-dessus, le problème de la contamination d’hémoculture complique la tâche du clinicien.
Ce problème est fréquent, puisque 1/3 voir la moitié des prélèvements qui reviennent positifs sont des faux positifs liés à la présence de contaminants introduits lors de la ponction veineuse en raison d’une mauvaise antisepsie du site de ponction.«
Et ici (concernant les pneumonies nosocomiales) :
« 1- Méthodes non invasives :
Les hémocultures sont d’une très grande spécificité mais d’une faible sensibilité de l’ordre de 7 à 25 %.
L’examen cytobactériologique de l’expectoration ou des sécrétions trachéales n’est déterminant que pour les bactéries non contaminantes des voies aériennes de type bacilles tuberculeux ou légionelle.
En dehors de ce contexte, la spécificité de cet examen est médiocre, de l’ordre de 30 %.«
Donc, même l’examen considéré comme le meilleur, n’est pas si bon que ça, vu qu’il n’est pas très spécifique en dehors de deux cas, la tuberculose et la légionellose qui ne touchent pas tellement de monde puisqu’elles ne concernent respectivement que 5000 et 1500 personnes en moyenne par an dans les années 2000 en France (loin des chiffres de la pneumonie donc). Par ailleurs, de nombreuses cultures (33 à 50 %) sont des faux positifs à cause d’une contamination. Donc, dans les rares cas où l’hémoculture est positive, en dehors de deux cas (tuberculose et légionellose) elle est peu spécifique, et en plus, elle est souvent sujette à contamination. Comme examen microbien ultime, ça se pose là.
Les techniques (biopsie pulmonaire et lavage broncho-alvéolaire) utilisées lors des cas graves sont intéressantes aussi. A priori, elles semblent plus spécifiques. Mais dans ce document-ci, on s’aperçoit que ce n’est pas le cas.
« La sensibilité et la spécificité de la technique permettent d’identifier correctement seulement 60 % des cas de vraies pneumonies nosocomiales. »
Plus loin :
« La sensibilité du lavage bronchoalvéolaire pour le diagnostic d’une pneumonie nosocomiale est estimée entre 47 et 91 %, sa spécificité entre 45 et 100 %. »
Donc, le fait qu’on reconnaisse que l’examen est peu spécifique va permettre de diagnostiquer des cas de pneumonie même s’il est négatif. Ça va laisser le diagnostic à l’arbitraire du médecin. Et si le traitement ne marche pas bien, on pourra dire que le test s’est trompé parce que pas assez spécifique. Donc, ça permet des explications ad-hoc si les choses n’évoluent pas dans le sens qu’elles devraient.
Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont les à-côtés de la technique. J’ai découvert ça via un cas sur le forum sidasante. Pour obtenir le lavage broncho-alvéolaire ou la biopsie pulmonaire, on fait une anesthésie locale ou générale. Seulement, quand c’est une anesthésie générale, les opiacé-likes utilisés pour endormir la personne vont provoquer une dépression respiratoire, qui va durer une journée ou 48 heures. Les médecins vont alors constater la chose et déclarer que c’est la pneumonie qui progresse (ou qui commence à se déclarer s’il n’y avait pas vraiment de symptômes probants avant). Donc, ce sont les médecins qui vont créer les symptômes cliniques de la maladie.
Et comme ils pensent que la maladie peut s’aggraver rapidement, ils vont mettre le patient sous antibiotiques immédiatement, sans chercher plus loin. Et si le problème passe, ils se diront que les antibiotiques ont été efficaces et que c’était donc bien une pneumonie. S’il ne passe pas, ils penseront d’abord qu’ils n’ont pas ciblé le bon microbe et referont une tentative avec d’autres antibiotiques. Si ça ne marche toujours pas, ils se diront que c’est peut-être une résistance aux antibiotiques. Et c’est seulement si la personne n’est toujours pas guérie qu’ils commenceront éventuellement à chercher ailleurs. Et bien sûr, si la personne meurt, là aussi, ça confirmera l’idée que c’était bien une pneumonie.
Alors, la médecine orthodoxe connait certains des problèmes liés au lavage broncho-alvéolaire et à l’anesthésie. C’est ce qu’on peut voir sur Wikipédia concernant les risques du lavage broncho-alvéolaire :
– Fièvre : 10-30 % – quelques heures après le lavage
– Bronchospasme : Hyper-réactivité bronchique connue (HBR)
– Créptitants : < 24h après le LBA
– Sibilant (sifflement lors de la respiration) : HRB connue – durée : 1-2 semaines
– PaO2 (pression partielle exercée par l’O2 dissout dans le sang artériel. Ca reflète, en situation normale, la quantité d’oxygène transportée par le sang et délivrée aux organes) : diminution transitoire
– VEMS (Volume expiratoire maximal par seconde ; volume d’air expiré pendant la première seconde d’une expiration dite « forcée », suite à une inspiration profonde) : diminution transitoire
– CVF (Capacité vitale forcée ; volume d’air expulsé avec force jusqu’au volume résiduel (VR) à partir de la capacité pulmonaire totale (CPT) : diminution transitoire
De la même façon, certaines conséquences de l’anesthésie générale ayant trait au présent sujet sont connues : comme la dépression respiratoire. Mais, ça n’est pas considéré comme fréquent. Donc, si ça arrive, on ne va généralement pas penser que c’est causé par l’anesthésie. Et puis, on reconnait qu’il y a des symptômes de type nausées et vomissements, ainsi que des sensations de faiblesse, qui sont clairement des symptômes ressentis en cas d’hypotension. Mais on ne parle pas d’hypotension en générale. Enfin, il y a les troubles passagers de la mémoire ou la baisse des facultés de concentration. Ça peut sembler ne rien avoir à faire avec le problème, mais il s’agit justement d’un élément conduisant au diagnostic de pneumonie chez les personnes âgées.
Donc, les médecins savent que l’anesthésie générale et le lavage broncho-alvéolaire peuvent entrainer des symptômes similaires à ceux de la pneumonie. Mais dans la pratique, les médecins ne vont souvent pas tenir compte du tout de ça. Ils vont considérer que c’est la pneumonie qui se développe.
Si par exemple, ils ont à faire avec une personne âgée de plus de 90 ans déjà bien affaiblie, il est clair qu’ils ne vont pas se gêner pour dire que les symptômes post-anesthésie générale et lavage broncho-alvéolaire (ou biopsie) sont ceux de la pneumonie.
Dans le cas trouvé sur sidasante, il s’agissait d’un bébé de 3 mois dont la mère est séropositive et qui a été emmené à l’hôpital pour un problème de manque d’appétit, de sommeil un peu plus important que d’habitude et d’un muguet buccal (en fait causé par l’utilisation d’extrait de pépins de pamplemousse en application locale). Avant que les médecins ne prennent conscience de la séropositivité de la mère, ils n’ont rien trouvé à la radio, et rien non plus au stéthoscope. Bref, l’enfant n’avait rien. Puis, tout d’un coup, ils se rendent compte de la séropositivité de la mère. Ayant donné des antibiotiques à l’enfant, ça le fait réagir positif au test vih (ici un examen de charge virale). Et d’un seul coup, ils décident de faire un scanner. Et comme par hasard, alors qu’ils n’avaient rien vu de problématique à la radio, le scanner est positif. Comme il est séropositif, ils font alors un diagnostic de pneumonie grave. En conséquence de quoi, ils décident de réaliser un lavage broncho-alvéolaire pour déterminer quel germe est en cause. L’anesthésie générale faite à l’occasion entraine une moins bonne oxygénation sanguine. Les instruments détectent ça. Et du coup, on considère que c’est la pneumonie qui s’aggrave. Finalement, on le met sous respiration artificielle et sous anesthésie prolongée. Bref, comme on le voit, on a un diagnostic complètement à la tête du client. Avant la connaissance de sa possible séropositivité, l’enfant était considéré comme n’ayant rien. Après, d’un seul coup, les médecins se mettaient à trouver non seulement une pneumonie, mais une pneumonie grave.
Le problème, c’est que le diagnostic de cas grave en lui-même repose en grande partie sur l’appartenance à un groupe à risque. Donc, à nouveau, un critère subjectif intervient à plein dans le diagnostic. A partir des mêmes symptômes, une personne qui ne fait pas partie d’une catégorie à risque va recevoir un diagnostic de bronchite ou au maximum de pneumonie bénigne, alors qu’une personne à risque va recevoir un diagnostic de cas grave de pneumonie.
En fait, il va y avoir une échelle de risque d’être un cas grave à l’intérieur des catégories à risque. Un vieillard de 90 ans et un nourrisson vont être tous les deux considérés comme « à risque » pour la pneumonie (et le vieillard est déjà considéré comme plus à risque que le nourrisson). Mais le vieillard va être considéré comme beaucoup plus à risque d’être un cas grave que le nourrisson. Donc, même si le vieillard a des symptômes moins importants que le nourrisson, il va avoir un risque plus grand d’être considéré comme un cas grave.
Par ailleurs, l’examen qui provoque les symptômes de pneumonie est fait plutôt chez des personnes dont on estime qu’elles sont à risque d’être des cas graves. Donc, plus on est dans une catégorie à risque, plus on risque de subir l’examen qui va renforcer le risque en question. Dans le cas des catégories à risque faible, la médecine se contente de juger au pif. Dans le cas des catégories à risque grave, on crée carrément les symptômes qui feront pencher le diagnostic du mauvais côté. On franchit une étape supplémentaire. On ajoute des tests pour faire en sorte de renforcer le diagnostic de pneumonie grave.
Donc, dans les cas supposés bénins, l’orthodoxie admet elle-même qu’on ne va pas disposer d’outils vraiment probant de diagnostic microbien (et bien sûr, encore moins dans les pays pauvres, où il y a 90 % des cas). Donc, le diagnostic va reposer pour une bonne part sur le pif (appartenance à un groupe à risque et impression personnelle du médecin). Bien sûr, il y a les autres outils de diagnostics (radio, scanner, symptômes cliniques). Mais ils ne permettent pas de juger de la nature microbienne de l’affection. Et dans les cas supposés graves, les outils ne vont pas être parfaits non plus. Donc, là aussi, il y aura une grosse part de pif. Mais surtout, on va souvent créer les symptômes cliniques de la maladie en mettant la personne sous anesthésie générale. Donc, le diagnostic de maladie grave va être en partie créé par les médecins eux-mêmes.
– Les symptômes cliniques
Les symptômes cliniques n’ont pas non plus grand intérêt, puisqu’ils sont très peu spécifiques.
Mais déjà, ça montre quand même qu’on pique dans des symptômes lambda pour construire une maladie. On n’arrive pas à avoir des symptômes très spécifiques.
Et puis, là encore, on a quelques informations intéressantes. En l’occurrence, on a les informations suivantes concernant deux types de populations à risque de pneumonie : les personnes âgées et les enfants.
C’est sur Doctissimo.
« La pneumonie du vieillard est grave. Les signes cliniques sont discrets. L’apparition étalée dans le temps ou simultanée d’une respiration plus rapide avec cyanose, d’une fébricule, d’un manque d’appétit avec asthénie, d’un état de prostration, d’une déshydratation progressive, non expliqués doivent faire évoquer le diagnostic de pneumonie et rechercher les signes physiques et radiologiques caractéristiques.«
On a aussi ça sur les pneumonies de l’enfant (déjà cité plus haut) :
« Les pneumonies de l’enfant sont de diagnostic plus difficile car les symptômes respiratoires sont rarement au premier plan. Le médecin doit savoir évoquer le diagnostic devant une fièvre élevée, des douleurs abdominales, des vomissements fébriles, des céphalées ou des convulsions fébriles pouvant faire évoquer une méningite ou une appendicite. La radiographie du poumon permet le diagnostic mais les images radiologiques sont parfois retardées de quelques jours par rapport aux signes cliniques.«
Donc, on a des symptômes relativement différents avec deux populations différentes. Ce qui donne encore un coup au sérieux du diagnostic. Parce qu’il n’y a aucune raison à une telle chose dans la théorie officielle. Mais avec mon explication, ces différences deviennent parfaitement logiques. Ce qui se passe, c’est tout simplement que chez les personnes âgées, le problème vient de façon prédominante des analogues d’opiacés, tandis que chez les enfants, le problème vient surtout des antibiotiques.
Chez les personnes âgées, l’hypotension et la détresse respiratoire provoquées par la prise d’opiacé-likes expliquent la cyanose, l’asthénie et l’état de prostration. L’effet sur l’appétit des opiacé-likes explique aussi la perte d’appétit et donc la déshydratation progressive.
Tandis que chez les enfants, l’agression du système digestif par les antibiotiques explique les douleurs abdominales et les vomissements fébriles. Et le yoyo entre un taux élevé puis bas du taux de cortisol (là encore provoqué par la prise et l’arrêt de l’antibiotique) explique les céphalées.
On note que pour les enfants, les problèmes respiratoires sont en fait rarement au premier plan. Ce qui est un euphémisme pour dire qu’ils ne sont pas présents. Donc, souvent, le problème n’a en réalité pas grand-chose à voir avec une pneumonie au sens où on l’entend généralement (un problème essentiellement pulmonaire).
Appartenance à un groupe à risque et autre type d’erreur de diagnostic :
Le fait de se voir diagnostiquer une pneumonie plus facilement si on fait partie d’un groupe à risque peut entrainer un autre type d’erreur de diagnostic. Une personne âgée ayant par exemple une embolie pulmonaire peut se voir diagnostiquer une pneumonie. Et la personne peut mourir à cause de cette erreur de diagnostic.
Conclusion :
Donc, bien sûr, les différents éléments du diagnostic ne prouvent pas l’origine microbienne de la maladie. Mais même sans tenir compte de cette problématique, le diagnostic présente de nombreux défauts rédhibitoires.
Une analyse critique laisse clairement à penser que la radio n’est pas fiable. D’ailleurs, les radiologues ne sont souvent pas d’accord entre eux concernant le diagnostic de pneumonie face à une même radio. On peut donc trouver un peu ce qu’on veut en fonction de la tête du patient. Selon le médecin, on peut avoir un diagnostic de pneumonie ou un diagnostic d’autre chose.
Les tests microbiens sont reconnus comme peu sensibles et/ou peu spécifiques. Donc, là non plus, on ne peut pas se reposer sur eux. Et du coup, là aussi, c’est la voie ouverte au diagnostic à la tête du client.
Or, si on adopte les principes de l’orthodoxie, le test microbien est tout de même le seul test qui permette de déterminer si on a bien affaire à une pneumonie (c’est-à-dire à une maladie microbienne). S’il n’est pas fiable, alors on n’a rien sur quoi faire reposer le diagnostic. La radio et les signes cliniques permettent seulement de déterminer qu’il y a un problème pulmonaire. Mais si les tests microbiens ne sont pas fiables, ça peut alors être n’importe quoi. Le diagnostic de pneumonie devient impossible.
Donc, même en adoptant le point de vue et les informations de l’orthodoxie, le diagnostic est très fantaisiste. Globalement, ça ne va reposer de façon fiable (et encore pas toujours) que sur les symptômes et l’appartenance à un groupe à risque. Le reste sera essentiellement là pour justifier la décision du médecin. Le fait de se reposer sur un ensemble de techniques assez high-tech donne une impression de sérieux. Mais en fait, si on multiplie les types de tests, c’est qu’on n’en a aucun qui se suffise à lui-même. Donc, on est obligé d’accumuler les tests non fiables pour se donner une impression de crédibilité. Mais, comme ça n’est pas fiable (et donc pas sérieux), si on change de médecin, on peut tout à fait changer de diagnostic. Mais comme les gens le font très rarement (pour la pneumonie en tout cas), ce défaut n’apparait pas aux yeux du grand public.
D’où le fait d’ailleurs que la méthode est souvent de type « on traite, et puis on verra si le patient guérit ». Et s’il guérit, on estime que c’était la pneumonie. Si ça dure, on pense dans un premier temps qu’on n’avait pas identifié le bon microbe, puis dans un deuxième temps que le germe est résistant, et dans un troisième temps que le patient a développé une maladie chronique suite à sa pneumonie. Et s’il meurt, on pensera là aussi que c’était bien une pneumonie. Il n’y aura vraiment que dans de rares cas qu’on reconnaitra que le diagnostic initial était faux.