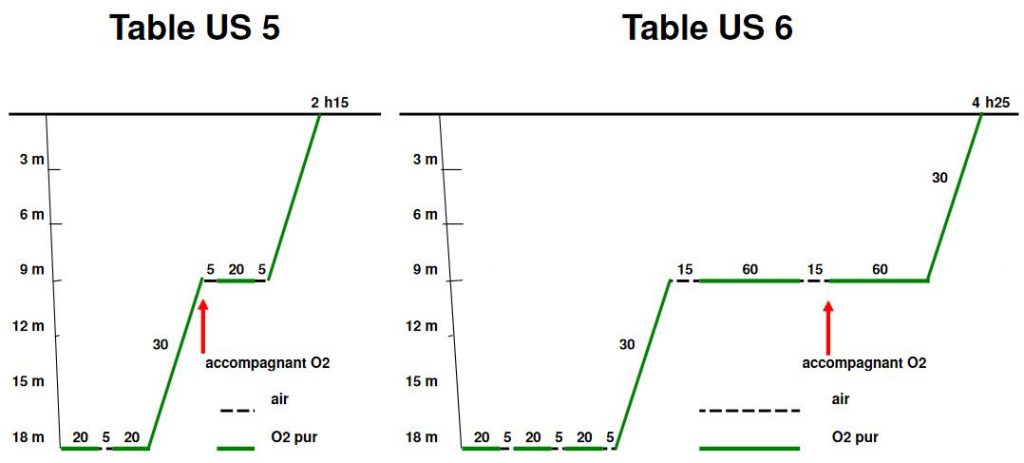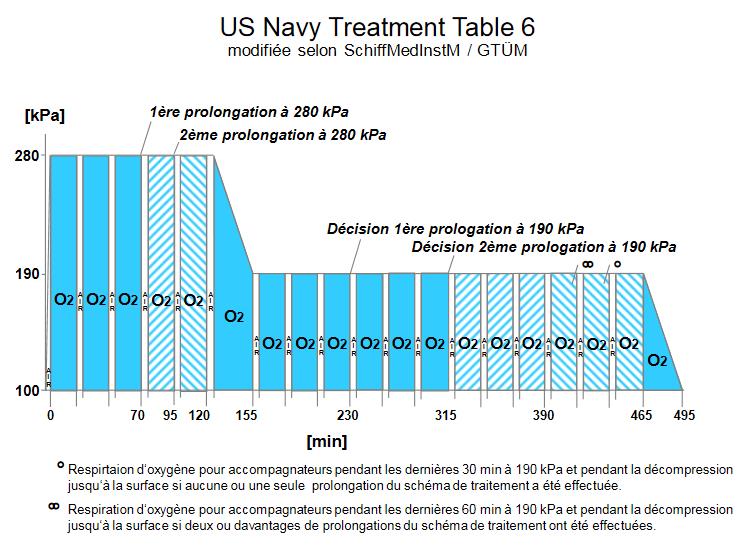En écrivant un article sur un des moyens qu’utilise l’orthodoxie médicale pour tuer les gens (spécialement les personnes âgées), j’ai été amené à m’intéresser à la toxicité de l’oxygène et du coup, aussi au monde de la plongée.
Et j’ai alors découvert une nouvelle cause possible aux accidents de décompression.
On peut en effet penser que les syncopes post-plongée ne sont pas forcément dues à des accidents de décompression. En réalité, c’est très souvent dû d’un côté à la fin de l’augmentation de la tension sanguine lié à la plongée et à l’arrêt de la respiration de quantités plus élevées d’oxygène, et de l’autre côté, à l’effet opiacé de l’azote.
Durant une plongée, la tension sanguine peut augmenter fortement. Il y a deux ou trois raisons à ça. Déjà, il y a le froid. Il est connu que le froid entraine une vasoconstriction des vaisseaux périphériques, ce qui augmente la tension sanguine. Et bien sûr, les frissons et le fait que le cœur batte plus vite pour lutter contre le froid font que la tension sanguine augmente. L’effort physique lié à la plongée augmente aussi la tension sanguine. Il peut y avoir également un stress de la plongée.
Par contre, ça n’a rien à voir avec la pression de l’eau. C’est ce qu’on peut voir ici : « Contrairement à ce que l’on a longtemps cm, il ne s’agit pas d’un effet pression. Les données disponibles sont suffisantes pour pouvoir l’avancer : en effet toutes les mesures recueillies lors de plongées expérimentales humaines, y compris les plus profondes réalisées à la Comex à Marseille jusqu’à 71 ATA (700 m) n’ont pas mis en évidence de variations significatives de la pression artérielle chez les plongeurs [Lafay & al, 1995], Le corps humain est composé majoritairement de liquides, donc incompressibles, et les effets pressions se répartissent de manière homogène sur tout l’organisme, et donc s’annulent. Ceci à condition, bien sûr, que les cavités gazeuses soient équilibrées avec la pression ambiante.
Les trois facteurs les plus significatifs sur la pression artérielle sont comme nous l’avons vu : le froid, la profondeur et le stress. »
Le problème, c’est que la pression partielle en azote devient rapidement élevée au fur et à mesure qu’on s’enfonce dans l’eau. Autrement dit, on respire beaucoup plus d’azote. A 10 m on en respire déjà 2 fois plus. A 20 m, 3 fois plus. Etc… Or, l’azote provoque un effet de type opiacé sur le corps. En fait, c’est lui le principe actif des opiacés et de la plupart des médicaments de type opiacé. Quand on analyse leur formule chimique, on se rend compte que leur point commun, c’est qu’ils contiennent tous de l’azote. Il n’y a que pour l’alcool que ça n’est pas le cas.
Et c’est aussi parfaitement clair quand on analyse les effets de l’azote en plongée. Ça provoque d’abord un effet d’euphorie, puis, un effet de narcose (d’endormissement), exactement comme un opiacé.
Le problème, c’est que l’effet d’hypertension provoqué par le froid, l’effort et éventuellement le stress va rapidement cesser une fois la personne remontée à la surface. Par contre, l’effet opiacé, lui, va durer probablement plus d’une dizaine d’heures.
En effet, d’une façon générale, les opiacés semblent avoir une durée d’action assez longue. Ainsi, on peut voir ici que les benzodiazépines ont une demi-vie qui peut durer 20 h ou plus.
« On distingue ainsi les benzodiazépines à courte durée d’action qui ont une demi-vie de moins de 20h (Zopiclone, Témazépam, Loprazolam, Lormétazépam, Estazolam, Clotiazépam, Oxazépam, Lorazépam ou Alprazolam), des benzodiazépines à longue durée d’action avec une demi-vie de plus de 20 heures permettant aux effets de se maintenir durant une plus longue période (Flunitrazépam, Nitrazépam, Bromazépam, Clobazam, Diazépam, Ethyle loflazépate, Nordazépam, Clorazépate dipotassique).«
Et sur Wikipédia pour l’opium, qui n’est qu’inhalé pendant quelques minutes :
« L’effet est rapide et persiste pendant 3 à 6 heures.«
Et c’est ce qu’on peut déduire indirectement de ce qui est dit ici :
« Comme l’azote en excès reste dissout dans les tissus pendant au moins 12 heures après chaque plongée, les plongées répétées sur 1 jour exposent à la maladie de décompression.«
Donc, quand le plongeur sort de l’eau, l’effet d’hypertension disparait. Il ne reste plus que l’effet d’hypotension provoqué par l’azote. Le plongeur peut alors se retrouver dans un état d’hypotension important et éventuellement faire un malaise. C’est aussi pour ça qu’on recommande de ne pas faire de sport juste après une plongée (après la séance de sport, il va y avoir hypotension).
Le froid et toute cause d’augmentation du taux de cortisol et de la tension sanguine vont retarder la prise de conscience que le taux d’azote devient trop élevé. Ils vont s’opposer aux effets de l’azote, ce qui fera que l’effet d’euphorie ou de narcose n’apparaitra peut-être que 10 ou 20 m plus bas que là où ça aurait dû le faire sinon. Mais le taux d’azote sera déjà trop élevé. Il sera bien présent, mais il y aura comme un contrepoison qui sera appliqué en même temps. Du coup, quand la personne remontra à la surface, elle risquera de faire un malaise, parce que là, le contrepoison ne fera plus effet, alors que l’azote continuera à le faire.
Alors, pourquoi très peu de plongeurs font un malaise après une plongée ?
Les plongeurs vacanciers plongent assez peu profond et pendant peu de temps. Du coup, leur taux d’azote reste relativement bas, et quand ils remontent, l’effet opiacé reste très limité. Ils vont être fatigués par l’azote. Mais, ils ne vont pas faire de malaise.
Les plongeurs plus passionnés ou les professionnels, eux, n’en feront que rarement parce qu’ils plongent plus souvent, ce qui fait qu’ils sont accoutumés à l’azote. C’est en effet, une substance à accoutumance. Plus on y est exposé, moins ça fait effet (comme avec les opiacés). Donc, une fois à la surface, ils ne sont pas assez en hypotension pour faire un malaise. En plus, ce sont en général des gens avec un physique solide, ce qui les rend plus capables de résister à l’hypotension.
Et, aussi bien pour les vacanciers que pour les professionnels, l’usage du Nitrox, démocratisé à la fin des années 90 a dû fortement aider. En effet, c’est un mélange enrichi en oxygène et appauvrit en azote. Le plongeur étant moins exposé à l’azote, ça limite l’effet opiacé et ainsi l’hypotension lorsqu’il revient sur le bateau.