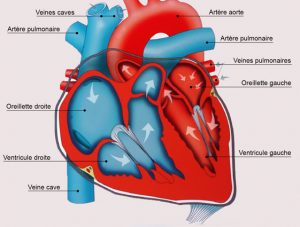La polio est une autre maladie emblématique de la théorie microbienne. Emblématique, parce que le succès de sa découverte au 19ème siècle est attribué à la théorie microbienne et à la méthode scientifique moderne ; parce que les symptômes ainsi que les traitements frappent l’imagination (paralysie, poumons d’acier) ; parce qu’elle peut être mortelle ; et parce que la vaccination a permis d’éradiquer complètement cette maladie dans les pays riches, alors que sans ça, il n’y a pas de traitement curatif.
La médecine moderne est à l’origine non seulement de la découverte, mais également de la disparition d’une maladie aux conséquences terribles. Donc, dans l’esprit des gens, c’est encore une victoire éclatante de celle-ci sur un fléau abominable. Et grâce au succès de la vaccination, entre autres, il semble impossible de douter qu’on a affaire à une maladie microbienne.
Seulement, comme on va le voir, il y a de nombreux d’éléments montrant au contraire que cette maladie n’a rien à voir avec un microbe, et même qu’il ne s’agit très probablement pas d’une maladie unique. Autrement dit, la polio n’existe pas.
Attention, l’article est long. Si vous n’avez pas le temps de le lire, il y a un résumé à la fin.
1) Données générales sur la polio
Officiellement, la polio est une maladie virale entrainant une inflammation de la moelle épinière, du tronc cérébral ou du cortex moteur. Le virus causant la maladie a été isolé en 1908 par Karl Landsteiner. Il est supposé se transmettre par les déjections. Il n’existe pas de traitement curatif contre la poliomyélite. Seul le vaccin protège de l’infection.
90 à 95 % des cas d’infection ne présentent pas de symptômes. Lorsqu’il y en a, cela se traduit par :
– des symptômes mineurs banals : maux de gorge, toux, fièvre, syndrome grippal, nausées, vomissements, douleurs abdominales, constipation ou, rarement, diarrhée. Ces symptômes disparaissent rapidement d’eux-mêmes.
– Un syndrome méningé lorsque le virus atteint le système nerveux central (céphalées, douleurs cervicales et dorsales, fièvre, nausées, vomissements, léthargie). Ou une forme encéphalique constatée presque exclusivement chez le nourrisson (fièvre élevée, modifications du comportement, crises convulsives généralisées, paralysie spastique, éventuelle paralysie faciale périphérique isolée). Là aussi, ces symptômes disparaissent tout seuls. (Note : la paralysie spastique consiste en l’étirement rapide d’un muscle, qui entraine ensuite une contraction réflexe qui dure un certain temps. En pratique, la personne n’arrive plus à rétracter le membre atteint et à peine à le bouger)
– Une maladie paralytique qui se traduit par la survenue d’une faiblesse musculaire croissante, jusqu’à la paralysie complète. Des symptômes mineurs (décrits plus haut) sont suivis après quelques heures de paralysies flasques sans que la personne ne perde le sens du toucher. L’atteinte est toujours asymétrique. La poliomyélite spinale affecte la colonne vertébrale et entraine le plus souvent la paralysie des jambes, mais parfois des bras. Dans le cas de la polio bulbaire, la capacité respiratoire est réduite (ce qui peut conduire à la mort en l’absence d’aide respiratoire), et des troubles de la déglutition et de la parole se manifestent. La forme bulbospinale combine à la fois forme spinale et bulbaire.
Voici un tableau obtenu sur Wikipédia donnant la proportion de cas sans et avec symptômes.
|
Situations cliniques |
|
|
Situation |
Proportion de cas |
|
Asymptomatique |
90-95 % |
|
Symptômes mineurs |
4-8 % |
|
Méningite aseptique non-paralytique |
1-2 % |
|
Poliomyélite paralytique : |
0,1-0,5 % |
|
79 % des cas paralytiques |
|
19 % des cas paralytiques |
|
2 % des cas paralytiques |